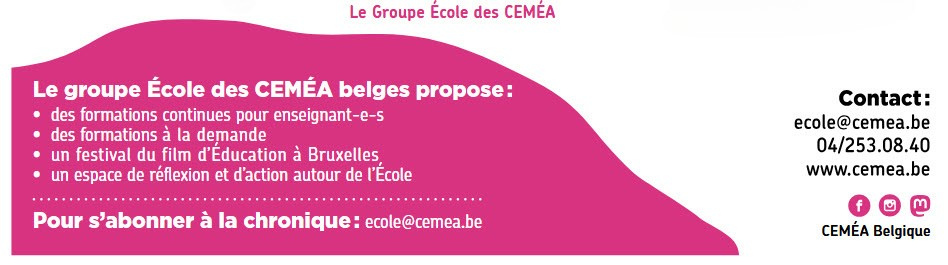Ah non, pas ce parent-là !

Lors de chaque rentrée scolaire, un petit frisson parcourt chaque membre de l’équipe éducative : comment seront les nouveaux parents ? Avec qui sera-t-il « facile » d’avancer et avec qui les relations seront-elles plus compliquées ?
Dans notre société, tout le monde a eu un parcours plus ou moins long et/ou compliqué dans l’enseignement, et a donc un avis sur ce que devrait être l’école et la manière dont elle doit être investie par les différentes parties. Si les jeunes et les parents collent des étiquettes sur l’école et les personnes qui la composent, les membres de l’équipe éducative en collent tout autant sur les jeunes et leurs parents :
- « Cette maman rouspète tout le temps »,
- « Eux ? Ils ne viennent jamais, ils sont démissionnaires »
- ou encore « Il ne parle pas français », « On ne peut rien lui dire »...
Une fois qu’une étiquette est collée avec le jugement qui l’accompagne, comment en sortir pour construire une relation de partenariat entre les différents adultes autour du bien-être de chaque enfant ?
Quand ils-elles arrivent dans l’école de leur enfant, les parents arrivent avec leurs vécus scolaires et leurs attentes vis-à-vis de la scolarité de leur enfant. Comme il n’y a pas de « bonne manière » d’être le parent idéal aux yeux de la société et de l’école, beaucoup font comme ils ou elles pensent être le mieux. Sauf que ce mieux n’est pas toujours perçu de la même manière par l’équipe éducative, qui centre son action sur les enfants et considère, parfois, les parents comme une seconde ligne avec laquelle il faut composer.
Dans certaines écoles, des stratégies de cloisonnement ou d’évitement à l’égard des parents sont mises en place. Cela se traduit par exemple par des barrières physiques telles que des grilles fermées, des horaires d’entrée et de sortie, des interdictions de pénétrer dans l’école, l’absence d’adultes disponibles à l’arrivée du matin, etc.
Dans d’autres contextes, ces barrières sont plus symboliques telles que l’empêchement de créer des structures collectives, le manque d’informations sur les lieux de démocratie scolaire où les parents ont une place, la grande difficulté de communiquer avec l’équipe éducative comme par exemple le fait de devoir s’adresser aux accueillant·e·s pour faire passer des messages de et vers les enseignant·e·s.
DANS UN MONDE IDÉAL, CHAQUE PARENT DEVIENT PARTENAIRE DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE ET TRAVAILLE DE CONCERT AU DÉVELOPPEMENT DE SON ENFANT ET DU GROUPE.Mais qu’est-ce qu’on risque à ouvrir la porte aux parents ? Pour commencer, on risque, au début, d’y consacrer du temps et de l’énergie. Comme chaque parent, chaque famille est différente, il n’y a pas une seule manière d’entrer en relation.
Ensuite, certaines relations nécessitent plus de travail lors de la rencontre, d’autres pour l’entretenir et d’autres encore pour poser des limites et les maintenir. En effet, il est indispensable de définir la place de chacun·e pour avancer ensemble dans une relation positive et bien-traitante centrée sur les enfants.
Une fois ce cadre posé, les relations peuvent devenir porteuses et durables à condition d’accepter une petite perte de contrôle (autre risque !) à travers l’échange de points de vue et de pratiques, parfois plus bénéfiques que celles prévues par les professionnel·le·s.
Le réel enjeu autour de la mise en place de cette relation est celui de la légitimité de chaque personne impliquée dans l’éducation de l’enfant, de la reconnaissance des rôles éducatifs qui sont bien complémentaires et non pas opposés.
Dans un monde idéal, chaque parent devient partenaire de l’équipe éducative et travaille de concert au développement de son enfant et du groupe. Les professionnel·le·s ne sont que de passage dans la vie des enfants alors que les liens entre parents et enfants s’inscrivent durablement dans le temps. Dès lors, il est important de soigner la relation professionnel–parent pour éviter, notamment, de créer un conflit de loyauté chez les enfants coincé·e·s entre les adultes.
Pour y travailler, il est indispensable de faire attention à la manière de s’adresser aux parents en présence de l’enfant. Chaque parole, chaque attitude traduit un message qui peut avoir des conséquences sur les relations actuelles ou futures. L’école et la maison sont des lieux où l’enfant passe le plus clair de son temps, jour après jour, pendant des années. Une forme de continuité doit donc pouvoir s’installer à travers une relation constructive basée sur la communication.
Évidemment, l’idée n’est pas de tout accepter de la part des parents ! Il est normal de ne pas être d’accord, encore plus quand cela concerne l’humain, mais il faut pouvoir avancer l’un·e vers l’autre sans s’enfermer dans des certitudes et des jugements respectifs.
L’école est un espace de socialisation, travailler ensemble entre adultes ne peut qu’être exemplaire. Rappelons qu’il incombe à l’équipe éducative, parce qu’elles-ils sont des professionnel·le·s de l’éducation, d’initier et d’entretenir la relation avec les parents. C’est une de leurs responsabilités.
Les lieux de rencontre
De nombreux lieux de rencontre existent à l’école. Ces entrevues peuvent se tenir de façon collectives ou individuelles, lors de moments formalisés ou plus informels.C’est parfois plus facile pour certain·e·s de discuter le soir à la « garderie », lors d’une fancy-fair ou d’un goûter dans la classe que lors d’une réunion individuelle avec l’enseignant·e ou l’accueillant·e ou dans le bureau de la direction.
D’autres préfèrent investir des lieux collectifs tels que les associations de parents ou même le conseil de participation afin d’obtenir des réponses et du soutien auprès d’autres parents avant de s’adresser à l’école.
Quel que soit le chemin choisi, le·la professionnel·le doit accueillir le parent en étant disponible sans contraintes mentales ou logistiques et en posant un cadre et des limites claires dès le début. Ainsi chacun·e peut se sentir en sécurité pour se lancer dans la relation avec l’autre.
Même si, en tant qu’enseignant·e, travailler avec des enfants était ce qu’on voulait, on ne peut pas faire abstraction des parents. En effet, derrière chaque enfant se cache un parent ou un·e adulte de référence.
Dans le travail d’éducation, l’enjeu est de dépasser les « Ah non, pas ce parent-là ! » pour fonder un climat de confiance, au mieux, un partenariat, ou au moins des échanges cordiaux sans perdre de vue son principal bénéficiaire : l’enfant !