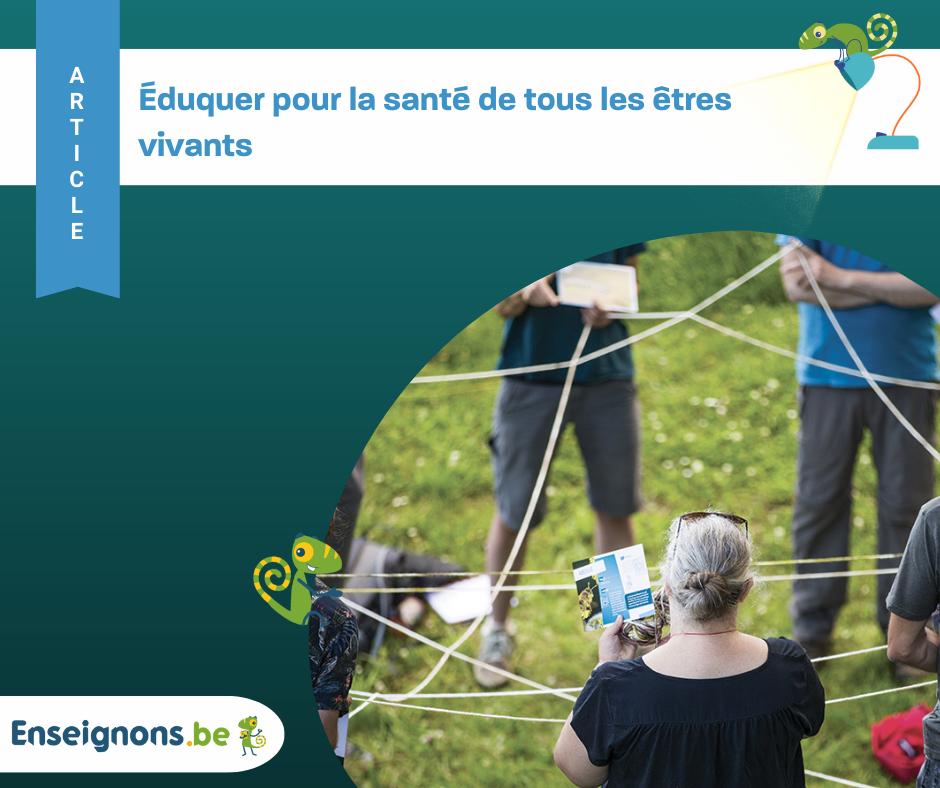« Enseignant·e·s : pas besoin d’être des super-héros pour changer des vies »

Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui< Il changeait la vie. »
Jean-Jacques Goldman, Il changeait la vie, 1987
Dans nos « salles de profs », il y a de très nombreux-ses SUPER enseignant-e-s. Celles et ceux qui, depuis début août, ont déjà en tête leur classe et imaginent des transformations de leurs pratiques, un nouvel aménagement, des projets de classe… D’autres qui se retrouvent pendant leurs vacances dans des congrès, des rencontres de groupes d’enseignant-e-s pour échanger, construire, rêver…
D’autres encore, plongé-e-s au rayon pédagogie de leur librairie ou en bibliothèque pour piocher de nouvelles idées et se former… Cette tribu d’enseignant-e-s est assez vaste et a la curieuse habitude de passer la fin de l’été à concevoir des dispositifs pédagogiques complexes pour répondre aux besoins de tous les profils d’élèves, à remettre chaque année tout en doute, à s’interdire d’entrer dans la routine.
Ces profs arrivent à l’école débordant-e-s d’enthousiasme et espérant être, jusqu’à la fin de l’année, les supermans et superwomans de l’éducation. Ce sont souvent celles-ceux qui parlent d’éducabilité des élèves qui sont particulièrement exigeant-e-s envers elles-eux.
En éducation active, la notion d’éducabilité est essentielle à l’école, mais aussi dans tous les autres champs de l’éducation, qu’elle soit formelle ou non-formelle : en famille, dans l’accueil extra-scolaire, en activité temps libre, en plaine de vacances… Pourtant, la définir est bien complexe. En effet, elle est absente des dictionnaires de référence. Sur le net, on glane quelques embryons de définitions assez vagues « capacité d’un individu à apprendre et à évoluer sous l’influence de l’éducation » ou « aptitude à être éduqué, à être modifié par l’éducation ».
Philippe Meirieu en précise le contour dans son texte « Le pari de l’éducabilité ». Il s’agit donc de partir d’une posture originelle à tout enseignement : l’élève est capable d’apprendre et, collectivement, tou-te-s les élèves sont aptes à apprendre ce que je leur enseigne. Cela ne signifie pas que tou-te-s en seront aptes dans les 50 minutes à venir, ni forcément dans la semaine ou d’ici le prochain bulletin… mais qu’elles-ils peuvent le faire tôt ou tard. Le point de départ est donc : ils et elles en sont capables. Derrière cette posture se dégagent une absence de fatalisme et une vision de l’apprenant-e qui lui rend la faculté à progresser pour lui-elle-même et pour celui ou celle qui l’accompagne.
Attention, dans la notion d’éducabilité, il n’y a aucun angélisme : l’apprentissage ne se fera pas par génération spontanée. Elle engage donc l’enseignant-e à tout mettre en œuvre pour forcer l’évolution attendue chez chaque enfant et, cela concerne aussi le petit Gaspard qui rêvasse près du radiateur ! Ce principe renvoie sans cesse une question aux professionnel-le-s : « Ai-je fait ce qu’il fallait pour que Gaspard comprenne ? ». En me référant au principe d’éducabilité, c’est ce que je lui ai proposé ou la manière dont je l’ai fait qui sera remise en doute, pas ses capacités.
L’éducabilité, c’est donc surtout, poser un regard bienveillant sur l’apprenant-e dès le départ de la relation. Une manière de lui transmettre l’ambition de sa progression pour échapper au combat pénible de la motivation où seules l’autorité de l’adulte et la contrainte poussent l’apprentissage. C’est aussi décider que l’élève a envie d’évoluer, d’apprendre, mais qu’il existe sans doute des dizaines de raisons qui l’en empêchent.
Le job de l’enseignant-e est de se lancer dans le déminage de celles-ci. Certes, ça prend du temps, mais quel enjeu modique à côté de ce que l’on (et par « on », on entend tou-te-s les acteur-trice-s) peut y gagner si ça fonctionne pour l’élève. Faire le pari de l’éducabilité de tou-te-s est un sacré défi, mais c’est aussi un risque que l’on s’offre, celui d’être surpris-e…
Et si l’éducabilité concernait aussi les enseignant-e-s ?
Un corollaire existe à ce principe d’éducabilité et il est de taille. Si, en classe, ce fondement est appliqué aux élèves, pourquoi ne l’applique-t-on pas à nous-même, nous les professionnel-le-s ? Pourquoi imaginons-nous que, dès la première rentrée scolaire de notre carrière, nous devons être des superwomans et supermans de l’éducation ? Pourquoi sommes-nous si peu tolérant-e-s avec nous-mêmes ? Pourquoi exigeons-nous de faire tout, tout de suite et bien ?
Nous, les adultes, sommes aussi capables de progresser, d’évoluer. Pour cela, il est intéressant de se donner un objectif (et il peut être ambitieux), de fixer sa « ligne d’arrivée » : un Michaël Jordan de l’accompagnement ou une Maria Callas de l’éducation. Puis, se réjouir de tout progrès qui nous en rapproche : qu’ai-je proposé aujourd’hui qui mène à ce but ? Célébrer chaque micro-victoire et, surtout, ne pas se focaliser sur ce qui nous en éloigne. Bien sûr, il est important aussi de « corriger » nos petites (ou grandes) défaites en « remettant sans cesse l’ouvrage sur le métier ». C’est la base du travail en éducation et ce qui en fait le challenge. Gardons en tête que nous pouvons cheminer, nous perfectionner et laissons-nous le temps de le faire !
Aujourd’hui, les élèves n’ont rien compris à ce que j’avais envie de leur transmettre. Je peux trouver la raison de leur incompréhension chez eux-elles (par exemple, elles-ils sortaient du cours de gym) ou je peux remettre en question mes choix, mon approche de la matière, mon attitude face à leur excitation post-sportive. Faire le pari de mon éducabilité, c’est donc ne pas me flageller, mais trouver ma manière d’évoluer, d’enseigner autrement la prochaine fois… Dans tous les cas, c’est rester bienveillant-e envers moi-même pour encourager ma progression et mon envie d’avancer, le tout dans la joie !
Un pari parfois qualifié de « Bisounours »
Ce principe d’éducabilité est souvent considéré comme une vision « Bisounours » de notre société. Évidemment, s’appuyer sur la croyance que tout élève peut évoluer, que le ou la collègue avec ses méthodes du 19e siècle peut s’améliorer, que l’école peut retrouver de la cohérence, que notre système éducatif peut arrêter de creuser les fossés sociaux paraît utopiste. Toutefois comment transformer les choses si nous n’y croyons pas par principe ?
S’il s’agit d’une version édulcorée de l’avenir, que dire d’une éducation pessimiste ? Si je déclare fin septembre que tel enfant ne réussira pas son année, vais-je faire en sorte d’avoir tort en juillet prochain ? Si je pense que notre système scolaire se délite d’année en année, vais-je pouvoir percevoir le bien-fondé d’une prochaine réforme ? Pour donner du sens à ce que je propose chaque jour aux enfants, je dois être convaincu-e que ça provoque quelque chose chez chacun-e.
Conclusion
Pour cette nouvelle année scolaire, offrons aux élèves de voir dans nos yeux leurs facultés à progresser, offrons aux collègues bougon-ne-s une petite porte vers une pensée plus positive… et, surtout, offrons-nous à nous-mêmes la chance de croire en nos capacités d’évoluer. Pas tout de suite, pas demain, mais dans un avenir plus ou moins lointain et forcément meilleur !