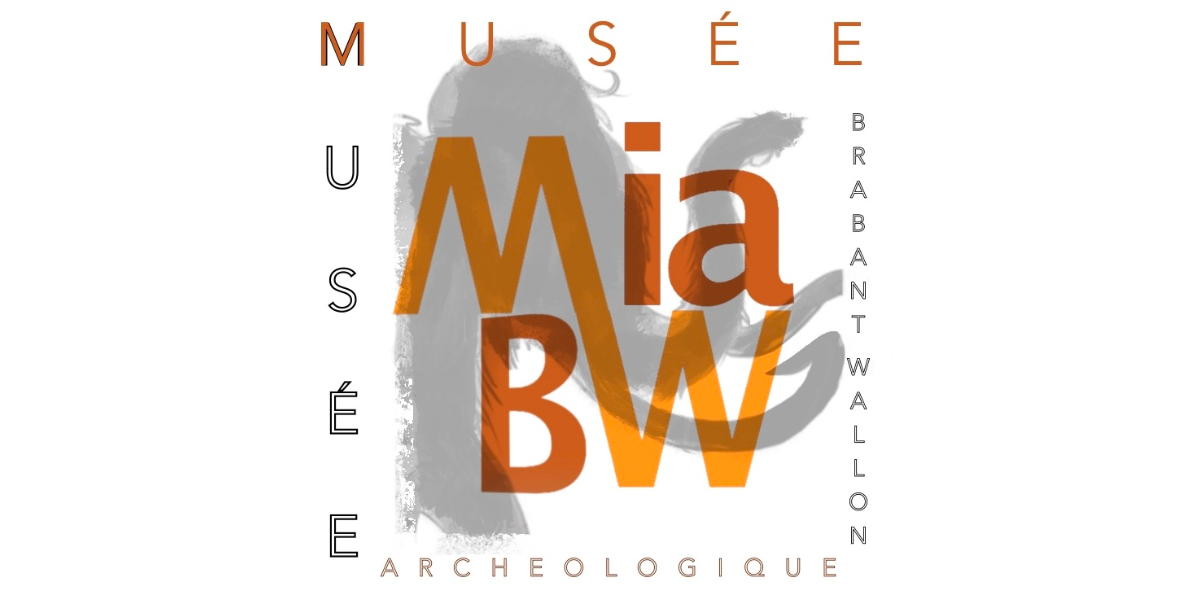Bruit à l’école : agis-sons !

Juin 2025, par Sophie Lebrun - Un article du magazine Symbioses n°144 : Environnement sonore - tendez l'oreille
A Bruxelles et en Wallonie, l’asbl Empreintes forme et accompagne les enseignant·es pour les aider à améliorer la qualité de l’environnement sonore dans leur classe et leur école. Exemple à Uccle.
Ce lundi matin, à l’heure de l’entrée
en classe, les couloirs de l’école fondamentale de Messidor, à Uccle,
sont étonnamment silencieux. Juste quelques voix d’adultes, convergeant
vers une classe. Logique : c’est journée pédagogique. L’équipe éducative
entame une formation de deux jours axée sur l’environnement sonore, en
particulier sur le bruit à l’école, en compagnie d’Annick Cockaerts et
Pauline Gillet de l’asbl Empreintes (1). « L’environnement
sonore, c’est un élément important du bien-être et du vivre ensemble
dans une école. L’excès de bruit provoque de l’énervement, de la
fatigue, et a un impact sur les apprentissages. Nous souhaitons
travailler là-dessus à long terme », indique le directeur, Serge Milinkovitch.
L’école
a d’ailleurs déjà commencé à se plonger dans le sujet, ces dernières
semaines – de quoi nourrir les échanges lors de la formation. Chaque
enseignant·e a mené une première activité de sensibilisation au son dans
sa classe, deux classes-pilotes ont bénéficié de trois animations
données par Empreintes (2),
et les élèves ont mesuré le niveau sonore de l’établissement à
différents lieux et moments. La direction a aussi planché sur
l’installation de quelques panneaux acoustiques – de récup –, et espère
pouvoir remplacer les sonneries stridentes par des airs de musique.
Le bruit, c’est la vie
« L’objectif de la formation est de vous outiller pour vous aider à mettre en place un projet collectif autour du bruit dans votre école, et à agir par vous-mêmes dans votre classe », explique Pauline Gillet. Au menu : informations, animations à réaliser en classe, trucs et astuces pour réduire le bruit, pistes d’aménagements organisationnels et techniques, et ressources pédagogiques (3). « Attention, on n’a pas de baguette magique pour supprimer totalement le bruit. » Après tout, « le bruit, c’est la vie », et quoi de plus vivant qu’une ribambelle d’enfants, qu’un espace débordant d’activité comme une école. N’empêche, quand le bruit prend trop de place, que ce soit dans un réfectoire bondé ou en classe, il peut taper sur le système (physiologique et psychologique) des enfants et des adultes.
En témoignent les attentes des profs, exprimées en ce début de formation. Ils et elles espèrent notamment découvrir des activités et des techniques pour « favoriser le retour au calme après la récré », « apprendre aux élèves à chuchoter à certains moments », « gérer le bruit dans les moments de jeu », « nous préserver nerveusement, et préserver notre voix », mais aussi « réfléchir à notre façon d’être et à nos pratiques, qui génèrent plus ou moins de bruit ». Plus spécifiquement, comment travailler la gestion du bruit « avec les petits de maternelle, qui sont encore assez centrés sur eux-mêmes, qui (s’)écoutent moins », ou dans un lieu tel que la piscine (« un enfer au niveau sonore ») ? A chacun·e son contexte.
Par ailleurs, soulignent les formatrices, « le bruit – c’est-à-dire les sons perçus comme indésirables, perturbants –, c’est subjectif. Nous n’avons pas tous la même sensibilité au bruit. Nous vous conseillons d’en discuter avec vos élèves au préalable, de recueillir leurs ressentis. » Sans oublier d’évoquer aussi les sons agréables, bienfaisants (sons de la nature, musique...).

Une enseignante présente son échelle du bruit.
Photo ©Sophie Lebrun
Gare aux bruits qui piquent
Avant tout, il est utile d’éclairer quelques notions. Le son est une vibration. OK, mais « comment montrer cela aux enfants ?
» Les enseignant·es découvrent des expériences simples à mener en
classe. Une flamme danse au rythme de la musique, des grains de riz
sautillent sur une membrane (4), du sable forme des motifs géométriques sur une plaque de métal (5)
: surprise et émerveillement garantis. D’autres activités mobilisant
tantôt les sens, l’habileté manuelle ou la capacité d’analyse, aident à
appréhender les caractéristiques du son (hauteur, intensité…) et
l’audition humaine. « Cela rejoint le programme de sciences », se réjouit une institutrice.
Divers
supports sont aussi présentés, qui aideront à aborder et à gérer
l’environnement sonore et ses effets sur la dynamique de groupe et sur
la santé. Il y a l’échelle du bruit, visuelle et tactile, allant des
sons doux/agréables (velours, couleur verte) à ceux qui
piquent/dangereux (matériau qui accroche, rouge), en passant par les
sons vivants et les sons fatigants.
« Chouette outil à fabriquer avec la classe
», réagit une institutrice. Il y a aussi l’histoire de Décibelle et
Groboucan, personnages contrastés en quête d’harmonie – dont la classe
peut aussi créer ses propres marionnettes. Ou encore le jeu L’Odyssée
des sons (voir ici). Tout cela fait germer d’autres idées : une enseignante projette d’emmener sa classe à la découverte des sons du quartier.
Lors de la deuxième journée, formatrices et enseignant·es échangeront
sur leurs pratiques : techniques pour moduler et préserver sa voix,
codes (gestuels, chantés…) pour inviter à parler moins fort, attitudes
encourageant l’écoute, yoga favorisant le calme et le recentrage…
Aménagements matériels et organisationnels
« Au terme de la formation, nous relate Pauline Gillet, chaque
prof s’est engagé à tester des actions ou activités à son échelle, et
une réunion de concertation a été programmée pour décider des
aménagements collectifs. » Résultat : « L’équipe a mis en place
pas mal de choses pour valoriser les comportements respectueux et mieux
gérer le bruit. Elle va notamment agir au niveau des couloirs (ôter le
mobilier encombrant et faire sortir les classes une par une) et au
niveau du réfectoire (repas tartines dans des locaux à part). Et
investir dans du matériel, neuf ou de récup’ : embouts ou balles de
tennis pour les pieds de chaises, tissu épais à placer sur certaines
parois, sonomètres et afficheurs sonores... ».
Chaque école a ses contraintes, en termes d’acoustique et d'organisation des bâtiments, de budget, etc. « Pour
réduire le bruit dans le réfectoire, certaines scindent le repas en
deux ou trois services. Mais le fait d’installer de plus petites tablées
peut déjà aider, explique Pauline Gillet. Un autre petit geste est de huiler les portes et y poser un joint acoustique. »
L’idée est aussi « d’aménager – ou se ménager – des moments et endroits où il y a moins de bruit
». Comme ce petit « chalet de lecture » récemment installé dans la cour
de l’école de Messidor : il joue aussi le rôle de refuge anti-bruit.
Infos : www.empreintes.be